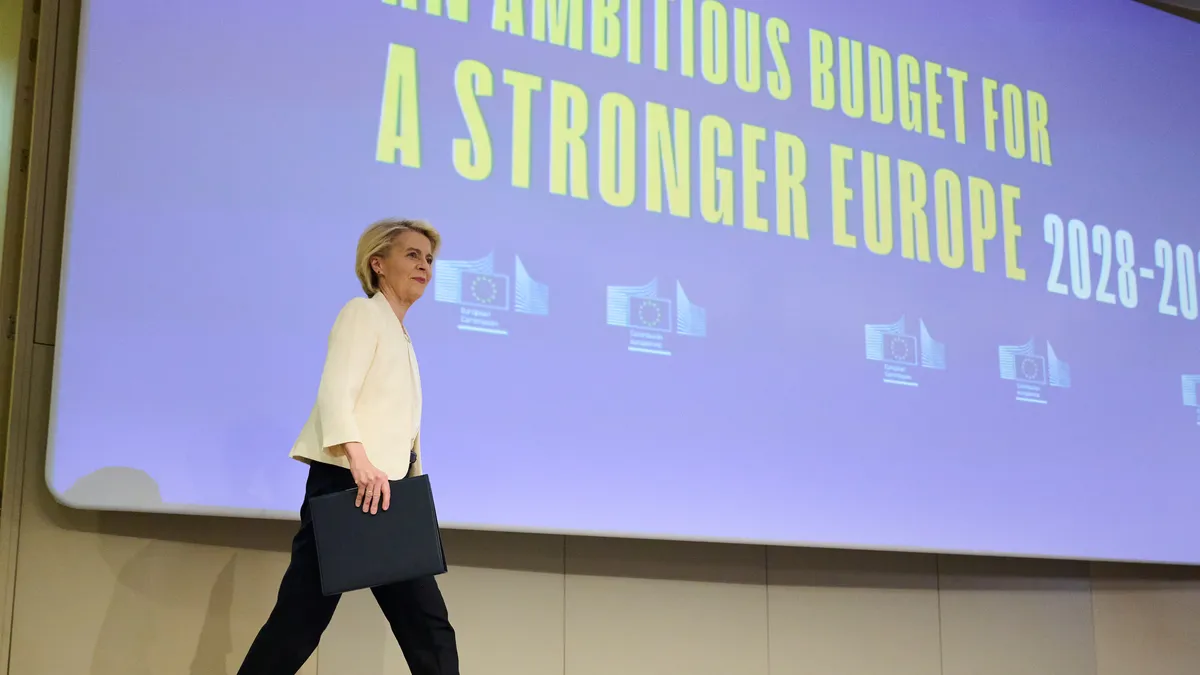Environnement
Les enjeux environnementaux s’insèrent de plus en plus dans toutes les politiques publiques. Cette édition Contexte est là pour décrypter la manière dont les législateurs français et européens tentent de concilier l'objectif de préservation des écosystèmes, voire leur régénération, avec les besoins économiques. Préservation de la biodiversité, gestion des ressources, prévention et réduction des pollutions représentent les axes principaux de notre couverture.